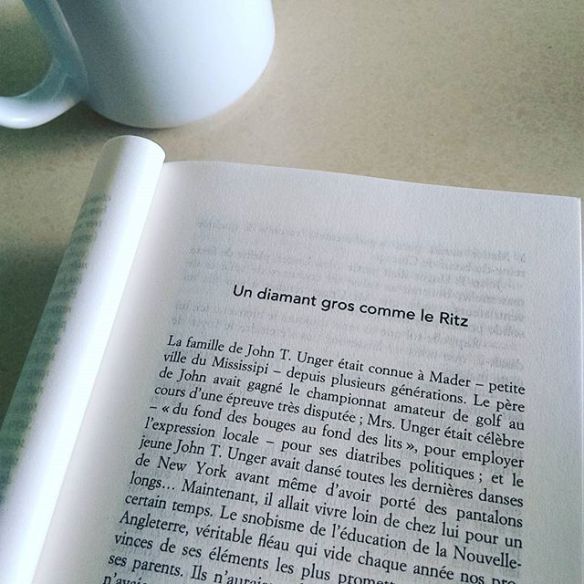Il y a tant de livres à lire et si peu de temps pour le faire que l’idée que je ne pourrai jamais tout lire en une seule existence (ni même en cent vies) me torture au plus haut point depuis mes sept ans, année où j’ai commencé à lire tous les Fantômette.
Afin de me donner bonne conscience et d’éviter de passer à côté de trop de bons livres, j’ai donc pris l’habitude, depuis quelques années, de me diriger vers les livres de mon choix tout en m’astreignant, en parallèle, à des challenges de lecture personnels.
Le dernier en date était le challenge My favourite book of all time que je compte bien reprendre et poursuivre dans les semaines à venir (je l’avais mis en stand by faute de temps) et qui consistait à lire le livre préféré de tous les temps de lecteurs anonymes ou non, au gré de leurs suggestions. Ca m’a permis de découvrir des tas de livres que je n’aurais jamais achetés ni lus spontanément, forcé à lire des classiques à côté desquels j’étais passée, et dans l’ensemble, j’ai aimé presque tous les livres que l’on m’a ainsi conseillée, parfois un peu et souvent même énormément.
Cet été, prise par le béton, le BA13, le tri du garage, les travaux d’apiculture, mes moults animaux et mes enfants à peine moins nombreux, je n’ai pas eu autant de temps pour lire que je l’aurais souhaité. J’ai néanmoins veillé à achever un challenge de lecture qui me tenait à coeur depuis ma nouvelle obsession pour le roman de Stephen Chobsky Le monde de Charlie (et son adaptation ciné, et sa BO), dont je vous ai parlé ici très récemment.


Dans le roman, Charlie se voit conseiller une liste de douze livres par Bill, son prof de littérature. Tout au long du récit, il évoque ses lectures et j’ai eu envie de lire ou relire à mon tour ces douze titres-là, juste pour voir.
Alors je vous rassure, je vais vous la faire courte et vous éviter des avis longs et chiants parce que douze livres d’un coup, ce n’est pas rien, et ce serait dommage que vous trouviez cette chronique un tant soit peu chiante, d’autant que certains livres de cette fameuse liste sont d’ores et déjà chiants en soi, alors autant ne pas en rajouter une couche.
Je vais commencer par les livres que j’avais déjà lus et que j’ai donc relus pour l’occasion.
Hamlet de Shaekespeare et L’Etranger de Camus en font partie.
Vous vous rappelez, d’Hamlet ? C’est l’histoire de ce type, qui est roi du Danemark et qui meurt, cédant sa place à son frère Claudius qui récupère son trône et sa femme, d’un coup d’un seul. Quelques temps après, le roi revient d’entre les morts sous la forme d’un spectre et annonce à son fils Hamlet qu’il a en réalité été tué par ce salaud de Claudius qui avait tout manigancé. En moins de deux, Hamlet décide de venger son père et choisit, comme arme absolue, de simuler la folie (ça marche toujours). Et c’est là que le bordel commence. La suite, vous la connaissez par coeur.
Si j’ai toujours aimé les tragédies de Shakespeare, je n’irai pas non plus jusqu’à dire que j’ai trouvé cela fascinant, sans doute parce que j’avais envie, en ces beaux jours d’été, de n’importe quoi d’autre plutôt que d’une histoire de trahison, de meurtre, de suicide et de folie.


Cela dit, j’aurais tort de me plaindre d’avoir relu Hamlet car on ne perd jamais son temps lorsqu’on relit Shakespeare. Je n’en dirais pas autant de ma seconde relecture que j’ai vraiment rechigné à attaquer de nouveau : L’Etranger de Camus. Parce que nom de Dieu, que c’est chiant ! A chaque fois que je m’entends penser cela, je repense à cette prof de fac qui vouait un véritable culte à Camus et ne jurait que par lui et je me dis que bah voilà, une fois encore, j’ai dû passer à côté d’un truc, j’ai pas dû bien cerner le génie du roman tout ça parce que j’étais en train de prendre le petit dej à La Brioche dorée au lieu d’assister au cours de littérature contemporaine dans l’amphi 3.
Bon, L’Etranger c’est l’histoire d’un type – Meursault – dont la mère meurt, et qui se rend à son enterrement sans que ça lui fasse ni chaud ni froid. Et après cela, il tue un arabe en le criblant de coups de feu et on ne pige pas très bien pourquoi il fait ça. Et ensuite forcément, il est arrêté et subit un interrogatoire au cours duquel il a l’air d’en avoir rien à foutre, et pendant son procès, c’est la même, il s’en cogne au point de dire qu’il a buté le mec parce qu’il faisait trop chaud ou un truc dans le genre. Et à la fin, ben on sait tous comment ça se termine. Et moi, malgré toute ma bonne volonté, j’ai pas réussi à trouver ça autrement que chiant et lourd ohlala, lourd comme c’est pas permis. Désolée Albert, au moins, on pourra pas dire que j’aurai pas essayé.


Pour l’occasion, j’ai aussi relu Walden ou la vie dans les bois que j’avais précisément lu quelques mois plus tôt. Walden, c’est le récit vécu par son son auteur, Henry David Thoreau, qui un jour prend la décision de tout laisser tomber pour aller vivre dans les bois, près du lac de Walden, et d’y vivre une existence simple et proche de la nature. Le livre est parfois un peu pénible et vieillot avec pas mal de longueurs mais qu’importe, ça reste un chouette récit qui donne envie, toutes les dix pages environ, de mettre sa maison en vente pour s’acheter un cabanon dans la forêt, et s’y entasser avec toute la famille pour mener une vie simple, équipés de canif et d’une ou deux casseroles.
Une fois encore, je me suis donc mise à fantasmer sur une vie loin de ce monde de dégénérés, loin d’internet, des supermarchés et des centres commerciaux, où ma carte Sephora Gold ne me serait plus d’aucune utilité. Mais bon, soyons honnête, cela relève bien évidemment du fantasme car je suis pas bien sûre que me laver les fesses dans l’eau froide de la rivière un jour sur deux soit une activité plaisante ni épanouissante (bien que sans doute fort raffermissante). Quand on lit le récit de Thoreau, on ne peut s’empêcher de s’écrier mentalement « mais purée oui, il a tellement raison !! », à chaque fois que celui-ci s’emploie à nous démontrer l’absurdité de notre mode de vie. Comme par exemple quand il évoque le fait de s’endetter trente ans pour acheter des appartements et des maisons trop grandes alors qu’on pourrait tous vivre dans des tipis ou des cabanons qui nous coûteraient que dalle et nous dureraient toute la vie. Ou alors la manie d’entasser des objets inutiles qui nous font perdre de l’argent et du temps. Mais est-ce que ce texte suffit à me convaincre de vendre ou balancer ma collection de figurines de série Z sous prétexte qu’elles ne servent à rien et m’obligent à dépenser un temps inutile en dépoussiérage hebdomadaire ? Je crains bien que non. Et puis soyons lucides, l’auteur a vécu l’expérience aux alentours de 1850 et j’imagine qu’à cette époque-là, c’était sans doute moins balèze de se passer de tout étant donné qu’on savait d’ores et déjà vivre sans le chauffage au fuel, le shampooing anti-pelliculaire, l’eau chaude et le wi-fi. Mais peut-être que je me trouve de fausses excuses et que je devrais investir pour de bon une cabane au bord d’un lac, faite de mes blanches mains (j’ai déjà du mal à monter une étagère Ikea en moins de douze heures, alors je vous raconte pas le bordel).


Le livre suivant de cette liste, que j’ai lu et relu est Gatsby le magnifique. Et là, pas la peine de s’étendre étant donné que tout le monde l’a déjà lu ou, dans le pire des cas, a vu la version cinématographique avec Leonardo en Gatsby décidément parfaitement magnifique.
Je crois que ce livre-là fait partie de ceux que je pourrais relire encore et encore sans jamais m’en lasser, autant dire que j’étais drôlement contente de le trouver sur ma liste de lecture et de retrouver l’ambiance des fêtes extravagantes de Gatsby, son immense manoir luxueux, son costume rose, l’histoire de la lumière verte au bout de la jetée, et bien sûr Daisy, toujours Daisy. Si vous n’avez jamais lu ce livre (ce que je refuse de croire, à moins que vous ayez moins de 20 ans, auquel cas je vous pardonne), jetez vous dessus nom de Dieu, c’est tellement beau que j’en chialerais. Et profitez-en aussi pour lire toutes les nouvelles de Fitzgerald, ce sera du temps rudement bien employé.


Et pour finir, dernière relecture de cette liste : Peter Pan de J.M. Barrie que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Pas la peine de s’étendre là-dessus, je refuse de croire quiconque prétendra ne pas avoir lu ce livre. Pour le coup, j’en ai profité pour le relire dans sa version originale et je l’ai trouvé dans une jolie petite édition pas très chère chez Penguin, dans la collection « Puffin Chalk », donc je vous pose le lien ici au cas où comme moi, vous êtes adeptes de la possession du même titre dans toutes les éditions disponibles.


Maintenant qu’on a passé en revue les livres que j’avais déjà lus, attaquons-nous aux découvertes de cette liste. Et pour que ce soit plus drôle, je commence par ceux que j’ai pas aimés et je garde les meilleurs pour la fin (sinon ce serait pas marrant hein).
Mais promis, je ferais vite.
Etant donné que, de toute façon, j’ai pas grand chose à dire sur ces livres-là (les nuls, je veux dire).
Je commence tout de même par L’Envers du paradis parce que c’est avec ce livre-là que la déception a été la plus brutale.
J’ai tellement lu et tellement aimé Fitzgerald que quand je suis tombée sur ce titre-là, que je n’avais encore pas lu, je me suis dit que chouette alors, ça ne pouvait que faire remonter le niveau de cette liste de lecture pas toujours marrante. Sauf que non, pas de bol. J’ai trouvé L’Envers du paradis assez plat et pénible, vieillot même, au point que je n’ai pas réussi à le finir (oui, j’avoue, j’ai calé à quelques chapitres de la fin). Premier roman de l’auteur, ce récit met en scène des personnages inspirés de l’entourage de Fitzgerald et on le reconnaît notamment lui-même derrière le héros Amory Blaine (un petit bourgeois hautain et passablement imbuvable). Comme je me suis beaucoup ennuyée en lisant ce roman je ne prends même pas la peine de le résumer parce que même ça, ce ne serait pas drôle. Je suis un peu déçue d’avoir été déçue par Fitzgerald, comme si une fois de plus, j’étais passée à côté d’un truc, comme si j’avais été la seule à ne pas comprendre la beauté de ce roman. Mais j’apprends tout doucement à ne plus m’en vouloir pour ça, alors disons que tant pis si je n’ai pas aimé.


Après ça, j’ai lu Sur la route de Kerouac. On m’avait dit que c’était un classique, un incontournable, un roman fondateur, l’emblème d’une génération, et je me suis dit que ça allait sûrement être cool de lire cet espèce de road trip infernal et effréné.
Ouais.
Sauf que non.
Sauf que j’ai très, très vite saturé. Et que je me suis ennuyée considérablement. Alors ok, les mecs se baladent de ville en ville, picolent comme des trous, s’envoient des filles, n’ont aucun but et ne vivent que pour le moment présent, sont sans foi ni loi, quittent leur femme pour une autre, laissent tout tomber pour partir vers de nouveaux horizons et tout ça, j’entends bien qu’à une époque, ça a pu paraître complètement fou mais disons que là maintenant, ça le paraît tout de suite beaucoup moins. Et souvent, ceux avec qui j’ai partagé ma déception après cette lecture m’ont répondu que l’intérêt du livre n’est pas tant l’histoire que son état d’esprit. Et je veux bien comprendre cela. Je veux bien comprendre aussi que l’impact de ce livre ne soit plus le même aujourd’hui qu’il ne le fut à sa sortie. Mais tout de même, j’ai trouvé ça d’un chiant sans limite, comme si je passais mon temps à tourner et tourner des pages qui toutes se ressemblent pour lire encore et encore les errances d’une bande de gars irresponsables qui ne pensent qu’à se bourrer la gueule, s’amuser et rouler en bagnole.
Sorry but not sorry, j’ai vraiment, vraiment pas accroché ni aimé ce livre-là, même si je me suis donnée un mal de chien pour tenter d’y arriver.


Avant-dernière déception (et là vous vous dites « mais mon Dieu, cette radasse est en train de nous dire qu’elle a pas pu pifrer un seul livre de sa liste ? », et vous avez presque raison, à trois livres près) : Le festin nu de William Burroughs.
La quatrième de couverture évoquait un livre « légendaire » et le titre me parlait pas mal, j’étais donc plutôt motivée quand j’ai attaqué sa lecture. L’ennui, c’est qu’après cent pages de délires de camés, j’en ai eu ma claque de ces consommateurs d’opium et de cocaïne, j’en ai eu marre de ce récit où les chimères de ces gros défoncés se mêlent au réel, et je me suis dit que si je ne le refermai pas précipitamment, j’allais sans doute finir par gerber. Bref, si vous aimez les ambiances folles et cradingues qui n’ont ni queue ni tête, Le Festin nu risque de vous plaire. Mais si comme moi vous reculez un peu devant ce genre de récits délirants et disparates, entre horreur, perversion et délires de défoncés, alors sans doute ne serez-vous pas non plus convaincus.


Pour en finir avec les livres chiants comme la mort, je décerne la palme toutes catégories confondues à La Source vive d’Ayn Rand, un roman dont je n’avais jamais entendu parler, qui m’a tout de même coûté 26,50 € (sa mère) et qui m’a ennuyé à mourir, d’un de ces ennuis mortels dont vous n’avez même pas idée. Ca m’a tellement gonflée que je sais même pas quoi écrire sur ce livre, je vous jure.
C’est lent. C’est chiant. C’est contemplatif. Ca nous parle du monde de l’architecture et de ses tragédies à deux balles avec, au coeur du récit, deux jeunes architectes que tout oppose : l’ambitieux pas forcément super doué et le génie condescendant et détesté. J’ai entendu parler de « monument littéraire » au sujet de ce livre (dont je n’avais jamais entendu parler auparavant) et quand je l’ai quant à moi abandonné (hors de question de compter sur moi pour perdre à nouveau plusieurs jours de mon existence pour terminer coûte que coûte un livre long et chiant à souhait où il ne se passe rien ou presque), je me suis demandée en quoi ce livre méritait d’être autant encensé. Une fois encore, je me suis demandée ce que mon petit cerveau inabouti n’avait pas été capable de comprendre ou de cerner, je me suis interrogée sur ma sensibilité peut-être tronquée qui m’empêchait sans doute de prendre en considération certains atouts du texte mais malgré cela, je n’ai pas réussi à trouver quoi que ce soit de bien dans ce livre que j’ai trouvé à la fois trop long, pas particulièrement bien écrit, et foncièrement imbuvable, à tous les niveaux. Bref, un livre que je ne vous recommande pas.
(Mais je vous mets quand même le lien au cas où y aurait parmi vous des dingues qui voudraient s’infliger ça)


Bon, après tous ces livres plus ou moins pénibles, on a bien mérité un peu de réconfort avec de vraies bonnes et belles histoires.
Voici donc les trois livres qui – avec Gatsby, bien sûr – m’ont vraiment plu parmi tous ceux de la liste de Charlie que j’avais, je m’en rends bien compte, parfaitement surestimée.
L’attrape-coeurs de J.D. Salinger (que tout le monde avait déjà lu sauf moi) est l’histoire d’Holden, un adolescent que l’on vient de flanquer à la porte de son école en raison de ses résultats lamentables, et qui décide de ne pas regagner immédiatement le domicile familial, afin de s’éviter les foudres de ses parents. Au lieu de cela, il prend la décision de séjourner trois jours dans un hôtel sordide de New York et de tuer le temps en ville, au gré de ses envies et de ses rencontres, jusqu’au jour fatidique où il devra rentrer chez lui.
Holden nous raconte ainsi, sur un ton très familier et très adolescent, ses errances dans New York, depuis l’hôtel miteux où il a élu domicile, jusqu’aux bars où il sort boire, danser et fumer, en espérant y faire des rencontres galantes. On a ainsi droit au récit de ses rendez-vous ratés, de son expérience désastreuse avec une prostituée et son souteneur, mais aussi à celui de ses souvenirs douloureux, comme la mort de son frère. L’histoire est aussi parfaitement touchante lorsque le narrateur nous parle de sa relation privilégiée avec Phoebe, sa petite soeur adorée, lorsqu’il évoque l’infinie solitude qui le gagne durant ses trois jours d’errance, et finalement la difficulté à traverser l’adolescence vers l’âge adulte.
Le roman est drôle et touchant, il se lit comme un rien et on trouve au milieu de toutes ces familiarités et expressions typiquement adolescentes beaucoup de poésie. Comme lorsque le narrateur décrit ce qu’il voudrait faire vraiment : « Je me représente tous ces petits mômes qui jouent à je ne sais quoi dans le grand champ de seigle et tout. Des milliers de petits mômes et personne avec eux, je veux dire pas de grandes personnes – rien que moi. Et moi je suis planté au bord d’une saleté de falaise. Ce que j’ai à faire c’est attraper les mômes s’ils s’approchent trop près du bord. Je veux dire, s’ils courent sans regarder où ils vont, moi je rapplique et je les attrape. C’est ce que je ferais toute la journée. Je serais l’attrape-cœurs et tout ».
Voilà, si comme moi, vous avez passé toutes ces années sans jamais avoir lu L’Attrape-coeur, remédiez au plus vite à cela, c’est un très joli roman, touchant et drôle à la fois.


Autre classique que je n’avais pas encore lu (sachez-le, j’ai des carences terribles en terme de littérature, sans doute parce que j’ai passé toute ma post-adolescence à lire des San Antonio et des SAS en boucle) : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee.
L’histoire se situe dans les années 30 dans une petite ville d’Alabama. Atticus Finch, un avocat bon et intègre, élève seul ses deux enfants, Scout et Jem. Il est commis d’office pour assurer la défense d’un Noir accusé d’avoir violé une femme blanche.
Outre le récit captivant et touchant qui entoure l’enquête et le procès, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur est avant tout un roman sur l’enfance. Raconté par Scout, la cadette, le récit s’attarde sur le quotidien de ces deux frères et soeurs, leurs jeux incessants, leurs explorations et leur obsession pour Boo Radley, le mystérieux voisin qui vit cloîtré chez lui depuis des années et qui alimente leurs histoires terrifiantes tout en attisant perpétuellement leur curiosité.
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur est vraiment un beau roman. Un roman sur l’espièglerie propre à l’enfance, sur l’Amérique divisée des années 30 et sur la lutte pour les droits civiques des Noirs. Au-delà des épisodes tendres et drôles sur les journées et occupations de Scout et Jem, le récit du procès est proprement captivant et on en se lasse jamais de lire ce livre que je ne saurais que vous recommander.


Et puis mon préféré pour la fin : Une Paix séparée de John Knowles.
Il s’agit à nouveau d’un roman sur l’adolescence (et vous savez comme j’aime ça) dont l’action se situe en 1942, dans un internat de garçons du New Hampshire, sur fond de guerre et de mobilisation.
Gene – le narrateur – est un lycéen brillant et conventionnel, inséparable de Phineas alias Finny, un jeune homme excentrique, rêveur, casse-cou et totalement indiscipliné qui l’emmène sans cesse dans des expériences improvisées. Monter au sommet de l’arbre et prouver sa bravoure en sautant sans peur dans la rivière ou foncer à bicyclette jusqu’à la plage pour passer un inoubliable après-midi en se fichant bien des horaires des cours, sont autant d’idées folles qu’émet Finny avant d’embarquer son ami Gene à ses côtés. Sportif hors pair, il lance et relève les défis mieux que quiconque, invente son propre jeu de balle (le « blitzball »), prétend que la guerre n’existe pas, et voue une amitié sincère à Gene qui de son côté, exaspéré par les excentricités et l’entrain permanent de son ami, ne peut s’empêcher d’émettre des doutes quant aux intentions de ce dernier. Se persuadant que Finny l’entraîne dans ses mésaventures dans le seul but de le détourner de ses cours, pour l’empêcher d’être le meilleur, Gene commence à vouer une animosité secrète envers ce supposé meilleur ami dont il ne peut s’empêcher de se méfier.
Balancé sans cesse entre l’impression d’être face à une amitié sincère et la peur de se faire avoir par un faux ami calculateur, Gene succombe malgré lui au doute et à la rancoeur et commet un jour l’irréparable : alors que tous deux s’apprêtent à relever le défi du saut périlleux dans la rivière, il fait volontairement bouger la branche sur laquelle se trouve son ami et le déséquilibre, provoquant sa chute. Désormais privé de l’usage d’une de ses jambes et devant renoncer à ses rêves de jeux olympiques de même qu’à tous ses inventions et expéditions d’autrefois, Finny regagne l’internat en n’étant plus que l’ombre de ce qu’il avait été. Gene vit dès lors dans une culpabilité permanente et s’emploie à taire les circonstances de l’accident afin de préserver cette amitié, désormais plus intense encore, qui l’unit à Finny.
L’histoire se déroule dans une atmosphère de conflit et dépeint le quotidien de ces étudiants liés par l’amitié mais seuls face à un destin incertain, vivant dans l’attente d’une mobilisation ou envisageant de s’engager pour prendre part à cette guerre. On y retrouve des personnages attachants, comme « Lépreux », le doux rêveur que l’on prend pour un simple d’esprit, et ce roman est définitivement LA bonne surprise de ce challenge lecture. Et rien que pour ça, je me dis que ça valait le coup de sacrifier un temps fou dans des lectures chiantes ou indigestes à souhait car si je ne m’étais lancée dans la lecture de cette fameuse liste, je n’aurais sans doute jamais lu Une paix séparée et j’ai vraiment, vraiment adoré cette histoire et l’écriture de John Knowles qui signe ici un très beau livre.


Voilà, je vous laisse avec tout ça, en espérant que ça vous donnera peut-être envie de lire l’un ou l’autre livre de cette liste (ou d’en éviter certains). Vous pouvez les commander en cliquant sur les photos, ou bien mieux, en allant directement chez votre libraire préféré (sauf si, comme moi, vous habitez à 20 minutes de bagnole et 4 balles de parking de la première librairie indépendante).
Tous les titres se trouvent plutôt facilement excepté Une paix séparée (pas de bol) qu’on ne trouve que d’occasion (ou neuf à des prix totalement délirants). J’ai dû braver ma peur de l’herpès et de la cocaïne sur les pages des livres de bibliothèque pour lire mon exemplaire sauvé du pilon, mais je vais vous dire, ça valait vraiment le coup, et même si j’avais chopé un herpès sur un coin de page, je crois que je n’aurais pas regretté cette lecture.
Et la prochaine fois, je vous parlerai de mon prochain challenge de lecture qui me prendra bien plus de temps que celui-ci (et qui, je l’espère, me décevra moins) mais après tout, on n’est pas pressé.

Là, c’est moi qui fais la gueule parce que je me rappelle que j’ai claqué 26 balles
dans le roman d’Ayn Rand